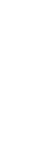Le 2 septembre 2020
Une voile meurtrie, jaunie, vieillie prématurément, ballote lâchement épuisée par un soleil harassant. Mollement étendu à l’ombre de celle-ci, un marin à la tête ébouriffée et le front perlant de sueur semble être plongé dans un sommeil semi-léthargique, lentement bercé par le roulis las d’une coque perdue au milieu de la Méditerranée. Seules quelques drisses lassées par une énième journée sans vent viennent battre le mât au rythme régulier de la houle, cri lointain soufflé au marin le priant de ne pas sombrer complètement.
Tout est confus. Le bleu du ciel vient se noyer dans celui de la mer dans une atmosphère laiteuse et écrasante. La rotation sera lente. Il faudra attendre la fraîcheur du soir pour faire renaître un espoir… Demain le soleil percera la ligne d’horizon un peu plus tard, laissant au marin quelques minutes de répit supplémentaire.
Fin août… Les éléments semblent avoir pris la fuite. Déserté. Pas le moindre nuage, même les longues traînées hautes dans le ciel ont disparu. L’espoir d’une goutte de pluie… oublié. Le vent n’ose plus souffler que quelques brises chaudes de temps à autre et le soleil, seul maître des lieux, brille bien haut dans l’immensité d’un bleu pâle écrasé par sa propre présence. Dériver, observer, guetter, patienter, bercé par un espoir difficile à définir.
Un point noir à peine perceptible.
Un petit bout de caillou au loin.
Un îlot que l’on pourrait presque toucher de la main.
Après de longues et vertigineuses journées de dérive, entre conscient et inconscient, entre bleu laiteux du jour et noir infini de la nuit, le marin se jette à l’eau. Et comme un animal blessé, il se traîne dans un dernier effort jusqu’à la terre ferme.
Un pin d’Alep, tassé sur lui-même et fermement ancré dans la roche, préside fièrement au sommet de ce ridicule petit morceau de roche. Deux naufragés bercés par le même espoir. L’espoir d’une pluie, l’espoir des jours qui rétrécissent, l’espoir d’un frisson pendant la nuit.
Le marin, plein d’interrogations, se demande comment cette graine, certainement larguée malencontreusement par un oiseau, a décidé de germer dans ce contexte pourtant si hostile. Ce désir spontané lui a-t-il fait redoubler d’efforts pour ensuite exister ?
Sûrement assailli par des vents violents, le pin, bien qu’aillant pris le parti de rester le plus bas possible, a suivi la direction des dominants, ses branches nous en indiquant le point cardinal. Chacune de ses racines enlace vigoureusement le moindre petit morceau de roche. Son tronc à l’écorce blanchâtre et son feuillage aux aiguilles finement clairsemées le prémunissent contre les attaques violentes d’un soleil salé et sans pitié.
Au fur et à mesure de ses observations et suppositions, le marin développe un sentiment de compassion, comme si un respect mutuel devait naître entre l’arbre et lui-même. Les deux rescapés ont du lutter contre les mêmes éléments, avoir les mêmes peurs, connaître les mêmes manques, prendre les mêmes risques et faire preuve de la même résilience, de la même humilité face à la nature. Mobiles ou immobiles, les espérances semblent identiques.
Dans la moiteur écrasante d’une fin d’après-midi, le ciel s’assombrit, l’horizon peu à peu se bouche. Une masse mouvante grise et noire, sombre et dense, avance. Illuminé par de puissants éclairs, le marin observe les reflets de l’eau au-dessus desquels le mastodonte glisse lentement, suivi par de profonds grondements longs et sourds. Le pin et le marin, collés l’un à l’autre, semblent tous deux vouloir se faire les plus petits possibles pour ne pas attirer les foudres de cette colère rugissante. La tête reposant sur ses bras croisés, le naufragé fixe au loin un horizon imaginaire et, dans la brièveté d’un éclair dont il sentit l’incroyable puissance électrique, aperçoit au loin la silhouette d’un bateau. Il se demande s’il ne s’agit pas d’un tour joué par son inconscient afin que son espoir ne s’éteigne à jamais.
L’orage maintenant s’en allait et c’est un calme céleste d’après tempête qui lui céda la place. Toujours blotti contre son ami, le marin sentit une légère odeur de fumée. Les yeux plissés, il scruta l’immensité, pensant peut-être apercevoir quelque chose. En vain. Et comme si depuis le début, instinctivement, son cerveau faisant mine de ne pas comprendre ce qu’il se passait, il finit par se résoudre à lever les yeux et voir ce qu’il redoutait tant. Le houppier de son compagnon de naufrage s’était complètement embrasé après le passage du dernier éclair.
Apeuré, désemparé, esseulé, le rescapé resta paralysé. Seules ses larmes scintillaient le long de ses joues comme une nuée de petites étoiles, éclairées par les dernières lueurs de son compagnon. Exténué, il s’effondra avec un sentiment d’incompréhension et de désespoir profond.
Ce sont des hurlements lointains qui, au petit matin, vinrent le réveiller. Il ouvra lentement ses yeux collés par un mélange séché de larmes, de cendres et de sable. Le bateau qu’il avait cru rêver pendant la tempête était au mouillage face à lui et déjà des membres de l’équipage venaient à son secours. Alerté par le feu, le bateau s’était dérouté pendant la nuit. La joie face à cet espoir renaissant de revoir enfin ses proches resta cependant ébranlée. Le souvenir de ces flammes hautes, calmes et sereines d’un feu lors d’une soirée d’été sans vent, le tourmentait. Il y eut ce soir-là, malgré l’effroi, un sentiment comme paisible d’une immense douceur, d’une bienveillance, sentiment qu’il n’arriva pas tout de suite à expliquer… Il lui fallut, quelques années plus tard, reprendre la mer et faire escale sur son île de naufragé pour comprendre. Il faillit ne pas la reconnaître car aujourd’hui, sur ce bout de caillou, trois petits pins d’Alep trônent fièrement. Les flammes de son ami d’errance avaient fait germer les graines de sa descendance.
Ce soir le soleil se couchera un peu plus tôt.
Charles Guerlain
Jardinier au Domaine du Rayol